Traumaland est partout

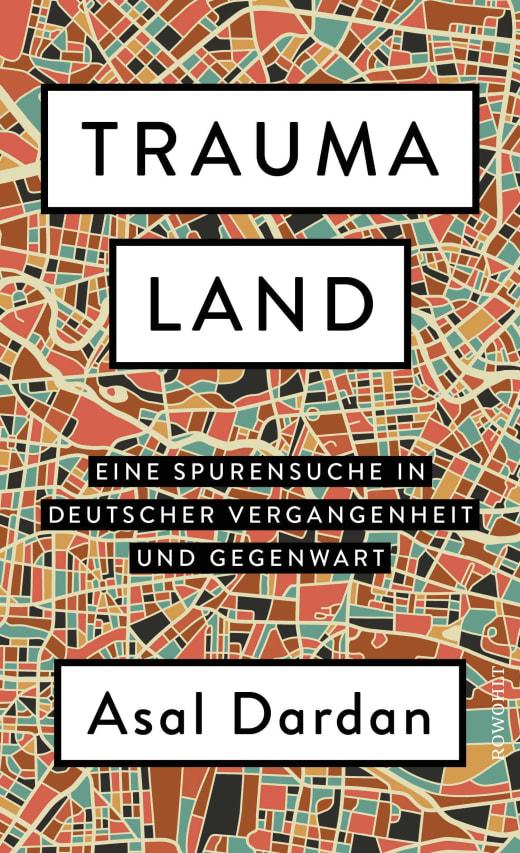 Rowohlt
RowohltAsal Dardan | Traumaland | Rowohlt | 288 pages | 24 EUR
Asal Dardan, née en 1978 à Téhéran, est arrivée en Allemagne avec ses parents alors qu'elle avait environ un an. Elle a étudié les sciences culturelles et les études sur le Moyen-Orient et a remporté en 2020 le prix Caroline-Schlegel pour l’essai avec son texte Neue Jahre. En 2021, elle a publié son recueil d'essais Betrachtungen einer Barbarin, dans lequel elle réfléchit à son expérience de migrante.
Son nouveau livre, Traumaland, est paru le 28 janvier 2025. L'autrice y dissèque la culture du souvenir, voire l’oubli délibéré de l'extermination des Juifs sous la dictature nazie ainsi que des nombreux meurtres de migrants en Allemagne, en particulier après la réunification de 1990. Elle s’oppose à l’oubli et refuse également que l’individualité des victimes de crimes violents — qu’il s’agisse de migrants après la Seconde Guerre mondiale ou de Juifs sous la dictature nazie — soit diluée dans des cadres abstraits au point qu’il ne reste presque plus rien des personnes elles-mêmes. Elle cherche dans les événements passés des schémas et des causes et remet en question les formes de mémoire mises en scène publiquement. J’emploie le terme extermination des Juifs plutôt que Holocauste, car en allemand, ce dernier crée déjà une barrière linguistique qui repousse, dans une certaine mesure, l’insupportable et la responsabilité qui en découle.
Je suis presque toujours d'accord avec elle, mais parfois, elle ne voit que ce qu’elle veut voir et non ce qui est — mais nous y reviendrons plus tard. En prenant l'exemple de l’Allemagne, Asal Dardan s’interroge sur la manière dont on peut supporter un monde où la violence (et pas seulement en Allemagne) augmente aujourd’hui de façon alarmante, et sur la façon dont on devrait se souvenir des victimes. Mon impression est la suivante : il s’agit d’une recherche, d’un tâtonnement, d’une tentative de mise en mots et d’assimilation de son propre savoir — à la fois vers l’extérieur, pour le lecteur, et vers l’intérieur, pour elle-même — afin de pouvoir affronter les connaissances qu’elle a acquises et les expériences qu’elle a vécues.
Quand j’ai commencé à lire ce livre, un souvenir marquant m’est revenu : un choc que j’ai vécu lorsque j’étais assistant d’un député écologiste au parlement bavarois. Un jour, vers 1998, je suis entré dans le bureau de presse du groupe parlementaire et j’ai vu sur la porte une grande affiche avec les noms de migrants tués en Allemagne. Il y en avait plus d’une centaine. Je n’avais jamais pris conscience de cette réalité avec une telle clarté. Je suis resté figé, comme foudroyé.
Asal Dardan ouvre son livre par un prologue. Il commence par cette phrase : « Ne pas pouvoir effacer le sang, ne pas pouvoir effacer le fait qu’il a coulé. » Et le premier paragraphe se termine ainsi : « Je marche dans le temps, cherchant la trace rouge. Je me demande ce qui dépasse l’accusation, ce qui vient après. » Il n’existe pas de réponse définitive : chaque lecteur doit la chercher et la trouver par lui-même. Mais l’autrice nous offre dans cette quête de précieuses pistes, au-delà des faits. Ce livre est une véritable mine d’informations, ponctuée de citations et de références à d’autres auteurs ayant abordé ce sujet (au sens large). Toute personne souhaitant explorer les thèmes de l’extermination des Juifs et de la violence contre les migrants y trouvera les voix de ceux qui ont su en parler avec pertinence. Un seul ouvrage m’a manqué au fil de ma lecture : Masse et puissance d’Elias Canetti. Ce prix Nobel de littérature écrivait en allemand, tout comme Asal Dardan, bien que ce ne fût pas sa langue maternelle.
Le premier chapitre, sans doute le plus long, intitulé Berlin (il manque malheureusement une table des matières), traite de la manière dont la commémoration est mise en scène dans l'espace public et de la façon dont on (nous, moi, l’autrice) y réagit. Les Stolpersteine (pierres d’achoppement) installées dans de nombreuses villes allemandes en mémoire des victimes juives ont été posées pour la première fois à Berlin. Asal Dardan s’y intéresse de près, car elles jalonnent ses pas lorsqu’elle se promène dans la ville où elle habite. Elle cite Hannah Arendt (à qui la nationalité allemande a été retirée en 1937), qui disait que le problème personnel de la persécution des Juifs n’était pas tant ce que faisaient les ennemis, mais ce que faisaient les amis. Il en va de même pour les attaques et les chasses à l’homme qui ont visé des collègues de travail et leurs familles en 1991 à Hoyerswerda, contre des travailleurs contractuels mozambicains, recrutés autrefois par l’Allemagne de l’Est communiste (voir également la recension La langue est aussi une arme).
Elle s’interroge, car elle n’arrive pas à comprendre comment des êtres humains peuvent en venir à dénier à d’autres leur humanité, au point de les classer comme sous-hommes, voire de leur retirer totalement leur statut d’êtres humains (voir aussi la recension L'esclavage n'est pas dans le monde, il est en nous).
À partir du deuxième chapitre, Cologne, la ville où l’autrice a grandi, l’ouvrage se concentre davantage sur le destin des migrants. Le fait qu’elle puisse appréhender plusieurs espaces culturels, en plus de sa curiosité intellectuelle, constitue à mes yeux un atout majeur dans sa lecture du passé et du présent de l’Allemagne. Je suis moi-même convaincu que l’on ne comprend vraiment son propre pays qu’après l’avoir quitté pour une période prolongée. En ce qui me concerne, cela signifie que de janvier 1985 à juin 1987, j’ai dirigé une coopérative de tisseuses artisanales dans la campagne tchadienne. Depuis 2005, je vis à Bruxelles avec ma deuxième épouse.
Elle est originaire de l’île Maurice. Un ophtalmologue munichois, avec qui elle avait travaillé en toute confiance dans une maison de retraite, lui a diagnostiqué en 2000 une cataracte, une maladie qui, si elle n’est pas traitée, entraîne la cécité. Pourtant, il a ensuite affirmé que les People of Colour (il a utilisé le N-Wort (N-Word), alors courant en Bavière) en étaient naturellement atteints et qu’elle n’avait donc pas besoin de médicaments. En 1996, elle a vécu plus de racisme en quatre semaines à Munich qu’en dix ans à Stuttgart. Pourquoi est-ce que je raconte cela ? D’une part, parce que le regard que l’on porte sur la réalité s’affine lorsqu’on connaît autre chose que son propre pays. D’autre part, parce que mon expérience personnelle me permet de confirmer ce qu’Asal Dardan décrit et analyse.
Le chapitre Dessau explore ce que signifie vivre dans un corps menacé. Trois meurtres horribles y ont été commis. L’un d’entre eux a très probablement été perpétré par un ou plusieurs policiers. Comme dans le chapitre Cologne, où les meurtres commis par la Nationalsozialistischer Untergrund (NSU, organisation clandestine néonazie) étaient déjà évoqués, on constate une fois de plus à quel point ceux qui sont censés garantir protection et sécurité au nom de l’État faillent parfois à leur mission — allant jusqu’à ne pas enquêter clairement sur des agressions, voire des meurtres, ou à ne pas les sanctionner de manière adéquate.
Le dernier chapitre s'intitule Hoyerswerda. J’ai été très surpris en le lisant. Je m’attendais à ce qu’il traite des attaques racistes déjà évoquées qui ont eu lieu dans cette ville en 1991. À cette époque, j’étudiais l’histoire à Heidelberg. Par hasard, j’ai remplacé un preneur de son pour un cameraman indépendant qui réalisait des interviews d’habitants de Hoyerswerda sur ces émeutes, afin de produire des séquences pour une émission spéciale diffusée sur la première chaîne de télévision allemande (ARD). Deux tiers des personnes interrogées soutenaient sans réserve ces violences, les approuvaient sans la moindre honte, sans le moindre signe de conscience de l’injustice.
Mais dans Hoyerswerda, il est surtout question du roman jeunesse Krabat, écrit par Otfried Preußler, dont l’histoire se déroule dans la région de Hoyerswerda. À travers ce texte, l’autrice tente de démontrer, si je l’ai bien comprise, que tous les enfants allemands ont été élevés dans la tradition nationale-socialiste, non seulement sous la dictature nazie, mais aussi longtemps après. Cela est certainement vrai pour les crèches et les écoles sous le régime nazi, mais en aucun cas pour les méthodes éducatives de tous les parents. Elle évoque — et ce n’est pas la première fois — la pédagogie noire. Sur ce point, je pense qu’elle se trompe. Selon Wikipédia, ce concept (que je ne connaissais pas auparavant) est fortement contesté par les spécialistes en sciences de l’éducation. Il désignerait une forme d’éducation basée sur une soumission totale des enfants à l’autorité parentale. Il existe sans doute quelques parents souffrant de troubles psychologiques qui élèvent leurs enfants ainsi, mais présenter cette approche comme un modèle général en Allemagne me semble incompréhensible. C’est un exemple, comme je l’ai mentionné plus tôt, où Asal Dardan ne voit parfois que ce qu’elle veut voir.
Elle commet également une erreur historique. L’histoire de l’orphelin Krabat, qui devient apprenti dans le moulin d’un sorcier, ne se déroule pas pendant la guerre de Trente Ans (XVIIᵉ siècle), comme elle l’affirme à plusieurs reprises et l’intègre dans son argumentation, mais durant la Grande Guerre du Nord (XVIIIᵉ siècle). Ce conflit marque l’ascension de la Russie, qui triomphe des Suédois à Poltava sous le règne de Pierre le Grand. Auguste le Fort, prince électeur de Saxe et roi de Pologne, participe à cette guerre avec ses territoires. Par ailleurs, le deuxième siège de Vienne par les Turcs est également mentionné dans le livre : le sorcier raconte en effet aux compagnons meuniers une histoire de sa jeunesse qui se déroule dans le camp de l’armée ottomane devant Vienne. Dans le récit, Auguste le Fort (son nom n’est pas explicitement cité) visite le moulin par hasard et brise un fer à cheval pour démontrer sa force.
Krabat est une histoire où le mal est vaincu par l’amour. Après que Krabat a été libéré par sa jeune fille, le sorcier meurt et les compagnons meuniers perdent leurs pouvoirs magiques. Ensemble, Krabat et son amoureuse quittent le moulin. À ce moment-là, la neige commence à tomber "comme de la farine". C’est la dernière phrase du livre. L’autrice en tire la conclusion que cette farine ne symbolise pas simplement de la farine, mais fait référence à la farine d’os humains que les compagnons meuniers devaient moudre une fois par mois pour le diable, qu’ils le veuillent ou non. Sur ce point, je ne peux pas adhérer à son interprétation.
À un moment donné, l’autrice s’interroge sur la pertinence d’aborder encore aujourd’hui l’histoire de la violence allemande. Elle semble faire allusion à la situation mondiale actuelle, marquée par une multiplication des guerres, et peut-être aussi à l’augmentation des violences commises par des migrants en Allemagne. Pourtant, Traumaland est un livre important. Tout simplement parce qu’il est essentiel de continuer à interroger l’histoire de son pays. Chaque nation devrait le faire, mais tous les États et tous les individus n’en sont pas capables. Moi aussi, j’ai parfois eu du mal à lire Traumaland. À ce jour, je suis encore incapable de regarder La Liste de Schindler, car, durant mon adolescence et mes années de jeune adulte, je me suis tellement immergé dans l’étude de l’extermination des Juifs que je ne peux plus l’affronter émotionnellement. Mais je suis reconnaissant envers l’autrice pour la compilation minutieuse de faits sur la violence envers les migrants en Allemagne et pour sa réflexion approfondie sur les raisons qui ont conduit à de telles tragédies.
Nous, Allemands, avons toujours été considérés dans le monde entier comme particulièrement méticuleux. Nous l’étions aussi dans le mal, qui existe partout. Ce sont des Allemands qui, pour la première fois, ont exploité des êtres humains de manière industrielle. Ma mère, dont la meilleure amie à l’école était juive et qui a soudainement disparu du jour au lendemain, a explosé de colère lorsque, à 17 ans, je lui ai demandé : « Saviez-vous que le savon que vous utilisiez était fabriqué à partir de Juifs ? » Cela s’est réellement produit. Mais nous ne voulons plus jamais devenir de tels champions.



