Mieux comprendre la Chine (et nous)

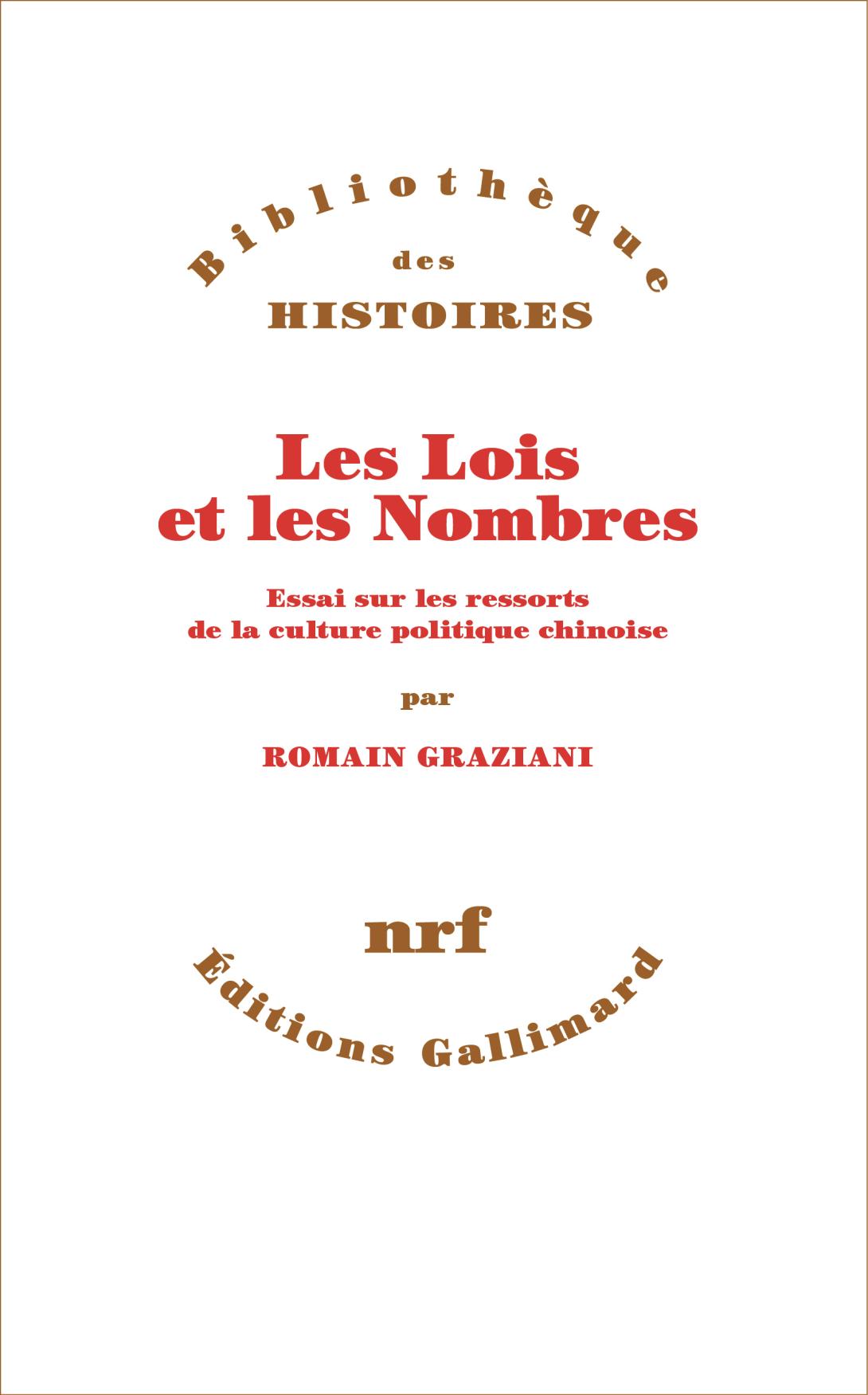 Gallimard
GallimardRomain Graziani | Les Lois et les Nombres - Essai sur les ressorts de la culture politique chinoise | Gallimard | 512 pages | 24 EUR
Romain Graziani est un sinologue français, professeur d'université, philosophe, poète et écrivain. Son livre Les Lois et les Nombres - Essai sur les ressorts de la culture politique chinoise est paru en 2025 chez Gallimard. Le terme français les ressorts peut être traduit par les mécanismes d'autorité comme la contrainte et l'obéissance. Il faut ici le prendre au pied de la lettre, car l'auteur travaille à travers des textes que les archéologues chinois n'ont trouvés qu'au cours des dernières décennies. Dans une conversation sur Youtube, Graziani dit avoir écrit un livre de 500 pages pour rendre les choses simples. Un bel indice que l'œuvre qu'il présente est très dense et complexe.
Romain Graziani écrit au début de son livre qu'il faut toujours garder à l'esprit, pour tout ce qui suit, le livre L'art de la guerre de Sun Tzu (Sunzi). Il aurait été écrit vers 500 avant notre ère (avant notre ère) et est considéré jusqu'à aujourd'hui comme l'un des livres les plus importants jamais écrits sur la guerre. Il a été publié entre autres en allemand, anglais, français, espagnol et arabe. Sun Tzu est le premier à décrire que celui qui gagne la guerre est celui qui analyse le plus précisément toutes les données disponibles et utilise sans scrupules les connaissances ainsi acquises. Son idéal est de ne pas avoir à mener une guerre, mais de la décider si possible à l'avance. Pour atteindre cet objectif, tous les moyens sont bons. Il n'existe aucune limite morale qu'il ne franchirait pas pour cela.
Le plus vieux slogan du monde
Le premier des huit chapitres s'intitule Le plus vieux slogan du monde. Il dit : Enrichir l'Etat, renforcer l'armée. Cette revendication est formulée pour la première fois par Shang Yang. Il est considéré comme le premier des soi-disant légalistes (il meurt en 338 avant notre ère). Ses enseignements ont été transmis et développés dans le Livre du Prince Shang. Il est probable que Shang Yang ne soit pas le seul auteur de ce livre.
Les légistes étaient des théoriciens de l'Etat et occupaient presque toujours des postes de direction. Ce sont des penseurs et des représentants d'une révolution fondamentale qui ont tenté de trouver une issue au chaos séculaire des Royaumes combattants (481 - 221 avant notre ère). Leur approche : la politique a besoin d'instruments pour réussir. La seule personnalité du souverain, qui souvent n'est pas vraiment à la hauteur de ses tâches, ne suffit pas. Il faut des lois et des institutions qui fonctionnent comme une machine bien huilée, indépendamment de la personne qui se trouve à la tête de l'Etat. Le souverain doit rester le plus invisible possible, sa domination est dépersonnalisée et donc éloignée des sphères humaines normales.
Confucius et ses co-penseurs défendaient encore l'idéal du souverain vertueux et exemplaire qui, dans l'ancienne tradition, devait répondre de ses actes devant le ciel en tant que Suprême. Le peuple et les conditions dans lesquelles il vivait représentaient pour le souverain un miroir dans lequel il pouvait voir s'il remplissait correctement sa mission céleste. Les légalistes ont détrôné le ciel et renoncé à toute morale. Seul comptait le souverain absolu, qui n'avait plus à répondre de ses actes devant le ciel. A ses côtés, des lois et des outils.
Les légalistes prônaient un système qui surveillait de près le travail des paysans. On leur prescrivait exactement la quantité de céréales qu'ils devaient livrer. La quantité qu'un Etat pouvait produire décidait en fin de compte de la force de son armée, selon la croyance largement répandue. La population est soumise à une militarisation totale. La moindre erreur, le moindre non-respect d'une loi entraînait des sanctions draconiennes qui étaient automatiquement appliquées, indépendamment des circonstances extérieures. De manière générale, les lois n'ont jamais été introduites pour protéger l'individu, mais toujours pour cimenter le pouvoir du souverain. C'est une différence fondamentale avec la Grèce et la Rome antiques, ainsi qu'avec les lois d'Hammourabi à Babylone (mort en 1750 avant notre ère), qui devaient notamment protéger les faibles contre les forts.
*L'esclavage n'est pas dans le monde, il est en nous - "Mondes d'esclavage - Une histoire comparée" est déjà paru en 2021 aux Editions du Seuil en France. Il traite de l'histoire de l'esclavage de la fin de l'âge du bronze à nos jours. La traduction allemande est enfin disponible. Une lecture essentielle.
Avec l'aide de nouvelles méthodes de calcul et d'impôts, un maximum a été tiré des ressources naturelles et de la force de travail de la population. On assiste à une refonte totale de l'organisation de la population, qui est enfermée dans un quadrillage étroit et une surveillance précise. (Le chinois antique ne disposait pas de mot pour désigner un homme libre. Voir aussi : L'esclavage n'est pas dans le monde, il est en nous*) Les commerçants et les artisans sont en soi suspects, car ils peuvent s'enrichir par leurs propres moyens. Les richesses doivent être à la seule disposition du monarque. La priorité absolue est donnée à la production agricole pour des raisons complexes et souvent irrationnelles, comme l'écrit Romain Graziani. Pour lui, la raison principale réside dans le fait que, premièrement, il faut nourrir l'armée et que, deuxièmement, les champs peuvent être mesurés, le temps de travail et les récoltes mesurés et pesés, et donc quantifiés avec précision.
Shang Yang n'a cessé de souligner la nécessité absolue d'une autorité souveraine. Il voulait au contraire maintenir le peuple dans la stupidité (ignorance) et la pauvreté (précarité). Un souverain à la vision large devait maintenir son peuple dans la simplicité rurale, dans l'épuisement physique. Ceux qui s'enrichiraient par leur propre initiative et leur intelligence devraient être expropriés, car ces personnes ne feraient que diminuer l'autorité et le prestige du souverain, tout comme la dignité des fonctionnaires. Mais l'administration ne s'appuyait plus sur les anciennes familles nobles. Celles-ci perdaient (dans un premier temps) leur participation au pouvoir. Seuls ceux qui avaient passé avec succès les examens prescrits devaient pouvoir faire carrière en fonction de leurs mérites.
Les théories et les idées des légistes furent systématiquement mises en pratique dans le royaume de Qin. Grâce à elles, le royaume devint si fort qu'il put peu à peu vaincre ses rivaux et son souverain s'établir comme premier empereur de Chine en 221 avant notre ère. Mais dès le règne de son fils, la dynastie Qin fut renversée en 206 avant notre ère. Les lois impitoyables entraînèrent une révolte et l'établissement de la dynastie Han. Celle-ci réintroduisit des éléments moraux du confucianisme, mais conserva la plupart des lois et la structure de l'administration. On dit encore aujourd'hui en Chine que le jour, on rend hommage à Confucius, mais que la nuit, ce sont les légalistes qui gouvernent.
A la fin du chapitre, l'auteur écrit : L’ignorance des lois de l’économie, le mépris moqueur du peuple et l’indifférence à ses souffrances, le recours systématique à la coercition poussé jusqu’à ses conséquences radicales pourraient faire de Shang Yang une sorte de préfiguration de la politique maoïste, n’était l’attachement viscéral du grand homme d’Etat de Qin à l’idée de loi objective et impersonnelle et l’indifférence à ses souffrances. Ni l'un ni l'autre ne s'appliquent expressément à Mao. Mao Zedong avait écrit un texte très positif sur Shang Yang dans son mémoire de fin d'études à la fin de sa scolarité. Plus loin, Romain Graziani écrit que les points de vue sur l'agriculture, le commerce, la guerre et la défense qui s'étaient formés à l'époque des Royaumes combattants sont restés des éléments essentiels de l'histoire de la culture politique chinoise.
Ainsi, dans son Grand Bond en avant (1958-1961), Mao Zedong a imposé aux paysans chinois des taxes sur les céréales totalement irréalistes. Dans le cadre du plan quinquennal, entre 20 et 40 millions de personnes mouraient de faim, tandis que les céréales pourrissaient dans des silos pleins. Elles devaient être vendues à l'étranger afin de générer des devises pour la construction de l'armée. Sous la dynastie Qin déjà, les réserves de céréales servaient en premier lieu à l'armée et non à nourrir le peuple. Xi Jinping a formulé cet objectif en 2013 : il faut réaliser une planification commune (imbriquée) de la construction de l'économie nationale et de la défense, afin de réaliser une unité parfaite entre la prospérité du pays et l'armée. Notez que Xi Jinping parle de la prospérité du pays et non de la prospérité des hommes.
Le réel et ses nombres
Les légalistes ont fait passer la pensée des anciennes voies mystiques à une modernité abstraite. Leur erreur est d'avoir tout poussé à l'extrême. Avant les légalistes, les chiffres jouaient déjà un rôle important dans la mythologie et la cosmologie chinoises. Mais dans le mode de pensée des légalistes, les chiffres ne sont plus seulement magiques, ils sont avant tout purement quantitatifs. La qualité disparaît, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Seule compte la quantité. Tout, jusqu'à l'homme, peut être exprimé en chiffres. Cela rappelle le positivisme européen et le fordisme/taylorisme américain, qui ont révolutionné la production industrielle, ainsi que le règne total des séries de chiffres 0 et 1 qui s'établit dans notre monde numérique.
Dans l'empire Qin, les soldats doivent prouver leur valeur par les têtes (dénombrables) des soldats tués et sont punis collectivement s'ils n'atteignent pas les quotas fixés. Celui qui met des chiffres sur les choses et les idées se procure un nimbe d'objectivité qui a un effet dissuasif et excluant. Ce qui est dit ne peut et ne doit plus être critiqué. Le grand rôle que jouent les chiffres dans la société chinoise jusqu'à aujourd'hui a pu être constaté chez Mao, tout comme aujourd'hui encore dans chaque campagne lancée par le gouvernement chinois. Selon Romain Graziani, il n'existe aucune civilisation sur notre planète qui ait jamais accordé un rôle aussi important aux chiffres. Deux affirmations à ce sujet : premièrement, la pensée chinoise a horreur de l'indéfinissable. Deuxièmement, sans chiffres, pas de contrôle, sans mesurer, pas de prise sur les choses.
Le nouvel outil du pouvoir
L'introduction d'une bureaucratie parmi les légistes, basée sur l'éducation et le mérite, a d'abord dû briser la résistance de la noblesse. Le fait que les lois soient publiées (Hammurabi le faisait déjà à Babylone) était également absolument nouveau pour la Chine. La noblesse considérait cela comme une limitation importante de son pouvoir, car le peuple pouvait désormais se faire sa propre opinion sur les jugements rendus. Confucius aurait également été contre la publication des lois. Il était également favorable à une stricte séparation des nobles et des non-nobles, sans laquelle il était impossible de gouverner. Les adeptes du confucianisme étaient d'accord avec les légalistes pour dire que la population devait être étroitement surveillée.
Pour les légalistes, une loi se distingue par quatre caractéristiques : 1. l'uniformité. Cela signifie qu'une loi doit être valable partout et ne pas permettre de divergences locales ou régionales. 2. lisibilité et clarté, de sorte que chacun puisse comprendre la loi. 3) Les récompenses et les sanctions prévues par une loi doivent toujours être prononcées indépendamment du statut et de la réputation de la personne. 4) Une loi s'applique de la même manière à la noblesse et au peuple. Romain Graziani ajoute : Historiquement, cette égalité de traitement est, avec le principe de la méritocratie, la seule forme d’égalité jamais conçue et appliquée dans le système politique chinois.
L'introduction du nouveau système au-delà du royaume de Qin dans toute la Chine n'a pas été facile et encore moins mise en œuvre partout. Les représentants de la bureaucratie ont dû assez souvent s'accommoder nolens volens des conditions locales. La rébellion et la résistance générale étaient très répandues. A l'instar de Louis XIV en France, le Premier empereur de Chine a forcé d'importantes familles nobles à s'installer dans la capitale afin de pouvoir mieux les contrôler. Les lois sévères devaient en théorie amener chacun à se comporter conformément à la loi par peur, de sorte qu'elles n'avaient pas besoin d'être appliquées, mais les légalistes avaient fait ce calcul sans tenir compte de la nature humaine. De plus, les représentants de l'administration impériale ne s'en sortaient souvent que par la corruption, car ils étaient mal payés. C'est justement parce que tout était pesé et mesuré avec précision que les lois et les contrôles stricts faisaient littéralement exploser les fraudes.
Comme nous l'avons déjà mentionné, la dynastie Qin a échoué après quelques années, principalement à cause de ses lois draconiennes. Parmi les chefs des insurgés, un simple fonctionnaire, Liu Bang, s'imposa et devint le premier empereur de la dynastie Han. Pour lui, l'adage Qui vole un hameçon finit à la potence, qui vole un royaume entier finit sur le trône.
Le culte de l'impersonnalité
A l'époque de la dynastie Zhou (1045 - 256 av.de notre ère ; elle comprend l'époque des Annales de printemps et d'automne de 1045 - 771 et celle des Royaumes combattants de 771 - 221 avant notre ère), le roi était encore considéré comme primus inter pares. Durant la période impériale chinoise (de 221 avant notre ère à 1911), la monarchie oscillait constamment entre deux modèles : régner ou gouverner. Celui qui règne célèbre sa vie loin des tâches quotidiennes, celui qui gouverne s'y consacre pleinement. Les légalistes partaient du principe qu'un souverain ne peut jamais faire confiance à ses ministres, pas plus qu'à ses sujets. Les gens ne devraient pas être éduqués pour devenir de meilleurs sujets, mais ils devraient être privés de toute possibilité de nuire à l'Etat. Un empereur n'exige pas de vertus et ne les encourage pas. Les deux seraient des efforts inutiles qui échoueraient toujours à cause de la nature de l'homme. Par conséquent, il ne se préoccupe que des normes et des procédures légales. Il fallait développer un cadre institutionnel étroit dont les contraintes n'offraient aucune marge de manœuvre non seulement aux collaborateurs les plus proches, mais aussi à tous les sujets pour ne pas respecter les lois. C'était la seule façon de faire régner l'ordre et l'harmonie.
*Un dictateur n'est qu'un être humain... - ...et c'est probablement la plus grande insulte faite à Xi Jinping. Eric Meyer (texte) et Gianluca Costantini (illustrateur) racontent la vie de Xi Jinping dans leur roman graphique "Xi Jinping L'Empereur du Silence"
Cette conception des légalistes constituait une attaque directe contre la position des sages dans le confucianisme. Pour gouverner un Etat, il fallait partir des besoins du plus grand nombre et non de ce qui servait les intérêts de petites minorités. Un empereur devait toujours et partout dans son empire occuper une position de pouvoir qui lui permettait, à lui ou à son premier ministre, de faire face à toutes les situations possibles. Dans l'idéal, l'empereur planait au-dessus de tout et de tous, sa personnalité individuelle ne devait plus avoir d'importance. Plus un empereur se montrait impersonnel, plus il apparaissait vénérable et puissant comme principe vivant d'une conception monarchiste de l'Etat. Le président chinois Xi Jinping, qui a dû apprendre dès son plus jeune âge à dissimuler sa pensée dans des conditions très difficiles, répond parfaitement à cette exigence des légalistes avec son expression faciale masquée admirée dans le monde entier. (Voir aussi : Un dictateur n'est qu'un être humain*)
Les légalistes n'ont jamais pu réaliser pleinement leur idéal d'information et de contrôle total. Personne ne pouvait déjà résoudre la contradiction selon laquelle un empereur devait déléguer la gouvernance quotidienne tout en contrôlant ses ministres à 100 %. Mais les légalistes étaient incapables de penser un autre modèle d'Etat que la monarchie. Les lois strictes associées au pouvoir absolu pouvaient trop facilement dégénérer en tyrannie, la résistance n'étant ni prévue ni possible au sein du système. Pour Romain Graziani, c'est là que réside le péché originel des légalistes. A long terme, les innovations et les progrès techniques, qui ont toujours quelque chose de subversif, ont également été entravés.
Compas, leviers et arbalètes : la mesure et la mort
Quasiment toutes les civilisations ont profité d'inventions techniques, du transport fluvial, des gonds de porte, du mécanisme d'une arbalète, de la balance avec des poids, de la roue. Mais seuls les Chinois ont fait de ces objets la base de leurs réflexions théoriques. La détente de l'arbalète, le moyeu de la roue et les outils à levier deviennent des marques de fabrique et des blasons pour les stratèges et les hommes politiques. On ne triomphe pas par la bravoure, ni par la force ou le pouvoir (force), mais par la ruse (machinations). Le vocabulaire actuel du pouvoir en chinois moderne est encore profondément marqué par des analogies et des métaphores qui se sont développées à l'époque des légistes sur la base d'outils. Dans ces images linguistiques se développe un monde imaginaire mécaniste qui conçoit l'efficacité comme un ratio entre l'effort et l'effet. La productivité et les moyens de pouvoir sont symbolisés par des outils à levier. Ce dernier se retrouve également dans le mot anglais leverage. Avec l'entrée des armes comme points d'ancrage de la réflexion politique, la loi découvre, selon Romain Graziani, son visage martial.
Primes et châtiments: l’épargne morale du légisme
Ce chapitre revient en détail sur les récompenses et les punitions, la carotte et le bâton. Certaines choses se répètent, mais sont enrichies de nombreux détails. Les fonctionnaires brutaux sont par exemple considérés comme des serviteurs de l'Etat tout à fait exemplaires. La vénalité, germe du désordre, peut être utilisée comme un puissant levier pour instaurer un ordre aussi absolu que celui qui régit les éléments du ciel. Celui qui est puni le sera souvent pour toute sa vie, par exemple par des tatouages sur le visage. Dans un article du Frankfurter Allgemeine Zeitung du 24 octobre dernier, un entrepreneur chinois qui a fait faillite compare son interdiction, en tant que débiteur, d'utiliser un train rapide à cette ancienne pratique.
Je voudrais ici citer un poème de Mao Zedong que Romain Graziani a placé en tête de ce chapitre :
Je vous conseille de ne pas critiquer le Premier Empereur,
Il faudrait reparler des lettrés enterrés vifs, du grand autodafé.
Le dragon ancestral est peut-être mort, mais Qin vit encore,
La culture confucéenne, si haut soit son renom, n’est que lie et rebut.
Depuis cent générations, Qin fait force de loi.
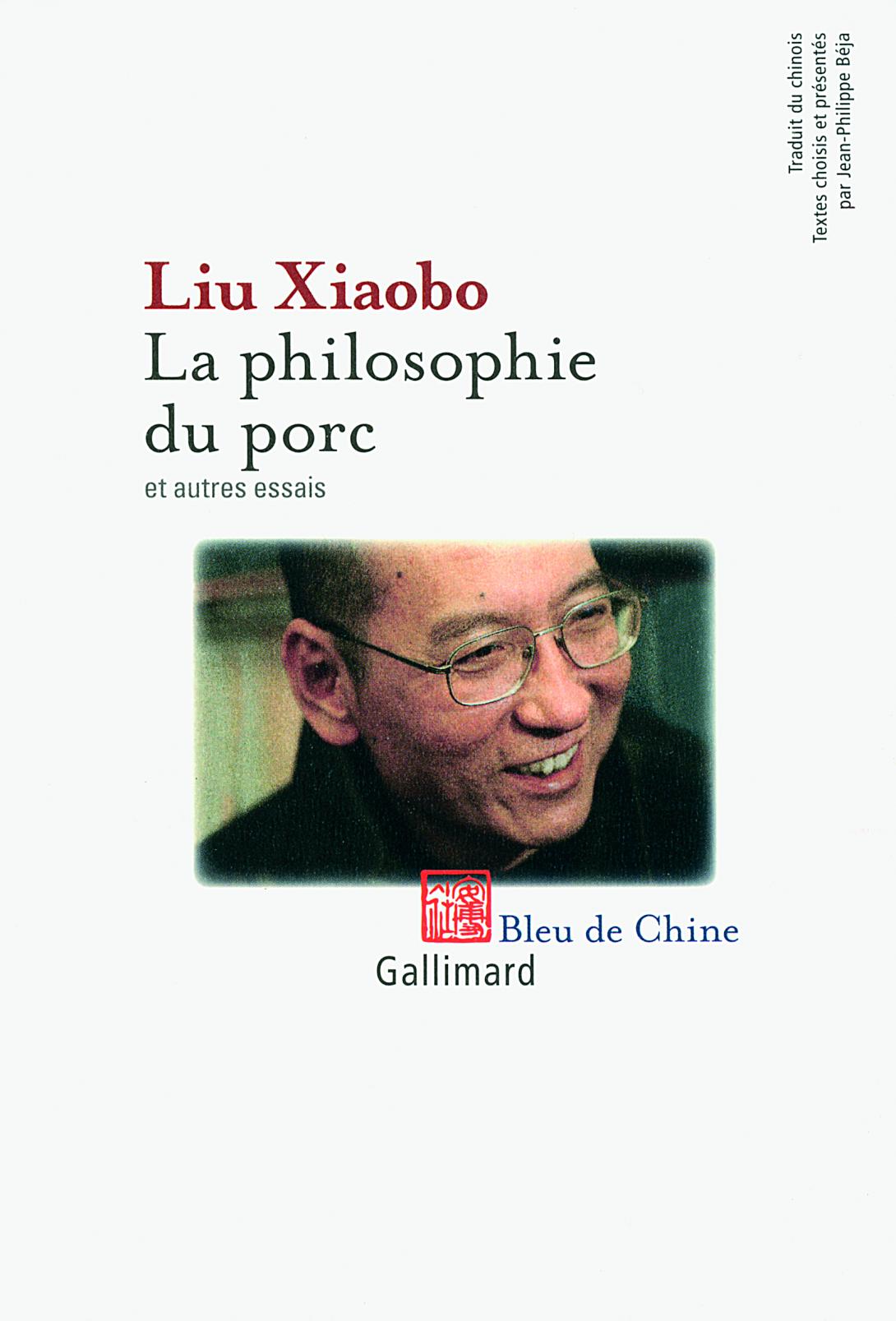 Gallimard
GallimardLiu Xiaobo | La philosophie du porc et autres essais | Gallimard | 528 pages | 26,40 EUR
Quiconque représente un danger pour l'autorité suprême est tué (quelques exceptions confirment la règle). Les exemples modernes sont le massacre d'étudiants contestataires en 1989 et la mort misérable de Liu Xiaobo en prison pour avoir refusé toute aide médicale pendant des années. Le lauréat du prix Nobel de la paix 2010 avait osé critiquer publiquement le pouvoir en place et appeler ses larbins par leur nom. (voir aussi : Liu Xiaobo La philosophie du porc, paru en 2011 chez Gallimard)
Surveillance et sujétion, de l'âge du fer à l'ère digitale
Romain Graziani voit une tradition chinoise de surveillance du peuple qui fonctionne sans interruption depuis 3000 ans. Depuis le quatrième siècle avant notre ère, il existe une obsession pour l'espionnage de la population. Il s'agit d'un trait fondamental de l'administration chinoise à travers les siècles. Un tel comportement n'a jamais existé dans une société antique comparable. Aujourd'hui, des millions d'yeux et d'oreilles humains ainsi que des capteurs automatiques s'activent au service du chef de l'Etat. L'idée s'impose que la récente évolution des technologies de l'information marque la toute dernière phase de mise en œuvre des possibilités théoriques que l'on trouve dans la doctrine de surveillance totale des penseurs légalistes. Aucun autre gouvernement n'exploite les nouvelles possibilités techniques de surveillance de manière aussi conséquente que le gouvernement chinois. Pour les Chinois eux-mêmes, cette surveillance n'a rien de fondamentalement nouveau, car elle ne constitue pas une rupture avec la tradition.
Sous les Qins comme dans la Chine contemporaine, les rumeurs, les rancœurs entre voisin, les dénonciations calomineuses et l’appât du gain bafouent l’inspiration originale de cette surveillance de chacun par tous au nom de la justice et du bien commun. Un exemple: le PCC appelle de nos jours à renforcer le niveau de surveillance des cadres dans les entreprises comme dans les administrations publiques, allant jusqu’à évaluer leur conduite en dehors de leur lieu de travail, en procédant à des enquêtes sur leurs moralité (fidélité conjugale, vie nocturne) ou leur éthique familiale. Mais ces contrôles auraient un coût, car ils entraveraient le développement économique de la Chine.
L'un, envers et contre tout
L'Un s'associe à l'harmonie et à la concorde. Le chiffre Un est depuis toujours considéré en Chine comme l'emblème de la Totalité. De l'Un, la Grande Unité, découle tout. L'ordre, le pouvoir, la prospérité, la stabilité et la paix sont indissociables du Un. Jusqu'au 20e siècle, on ne pouvait imaginer en Chine d'autre forme d'Etat que la monarchie. L'équivalent de l'Un, du monarque, est le peuple qui, sur une balance, est égal au poids de l'Un. C'est un symbole d'harmonie et signifie dans sa conséquence que le peuple est réduit à un ensemble enfantin.
Mais l'Un, c'est aussi la Chine elle-même. Le cercle culturel unique qui domine tout, le centre de tout. Tout comme les Grecs anciens, les anciens Chinois considéraient tous les autres comme des barbares. Curieusement, la Chine ne connaissait pas de frontières fixes. Il y avait le pays central et les vassaux, toutes les terres situées au-delà étaient considérées comme sans importance. Des mots comme Etat, pays et nation n'ont été introduits consciemment dans la langue chinoise que dans la seconde moitié du 19e siècle. La première frontière officielle de la Chine a été fixée en 1689 par le traité de Nertchinsk entre la Russie et la Chine.
La Chine se considérait traditionnellement comme (le système) Tout-sous-le-Ciel et donc comme supérieure à toutes les autres civilisations. La suprématie militaire de l'Europe et de l'Amérique au 19e siècle a également été un grand choc psychologique. On peut observer au 21e siècle, selon Romain Graziani, une tentative d'établir une synthèse entre l'Etat moderne et l'ordre céleste. Les écrits de Xi Jinping en fournissent la philosophie. Le culte de l'unité apparaît de plus en plus comme l'affirmation d'un destin supérieur qui conduit le pays vers son point d'achèvement ultime, en devenant le pivot d'un nouvel ordre mondial et donc le garant de la fin de tous les désaccords et de toutes les divisions.
Que la Chine ait de grandes ambitions, elle en a tout à fait le droit. Personne ne doit et ne peut lui contester ce droit. Mais personne ne devrait oublier ce que Roman Graziani écrit au début de son livre : que dans tout ce qui suit, il faut toujours penser au livre L'art de la guerre de Sun Tzu (Sunzi).
Ce texte vous a plu ? Alors soutenez notre travail de manière ponctuelle, mensuelle ou annuelle via l’un de nos abonnements !
Vous ne voulez plus manquer aucun texte sur Literatur.Review ? Alors inscrivez-vous ici !



