Après avoir lu Tajimara

Rodolfo Lara Mendoza est un écrivain colombien. Il a publié le recueil de nouvelles La gravedad de los amantes (Editorial UIS, 2016 ; Cero Squema Editores, 2022) et les livres de poésie Esquina de días contados (Pluma de Mompox 2003), Y pensar que aún nos falta esperar el invierno (Pluma de Mompox 2011) et Alguna vez, algún lugar (Turpin Editores, 2018), ce dernier inclus dans le recueil Palabra de Johnnie Walker, publié en Espagne.
Je ne sais pas quel mécanisme obscur m'a conduit d'une nouvelle de García Ponce à un vieil épisode que je croyais oublié, ni quelle importance elle pourrait avoir aujourd'hui. Il y a des chemins qui commencent dans les livres et finissent dans la vie, bien qu'en règle générale ce soit l'inverse.
La nouvelle s'intitule "Tajimara", et peut-être parce qu'elle est racontée depuis l'intérieur d'une voiture, sa lecture m'a ramené dans le passé. Ainsi, après l'avoir lue, je me suis revu, enfant silencieux, assis dans le bus dans lequel un voisin du quartier m'emmenait à l'école. C'était un bus jaune, destiné à transporter les travailleurs d'une entité publique. De l'un de ses sièges, j'ai vu, un matin pluvieux, les mêmes "sapins secoués par le vent, les montagnes brunes et le ciel gris et délavé" que voit le narrateur de "Tajimara". Pourtant, dans ma ville, il n'y a pas de sapins, et en guise de montagnes, il n'y a qu'une petite colline dont la végétation s'estompe au fur et à mesure que le temps sec avance.
C'était les années 80. Je vivais dans un quartier de banlieue. Dans une rue qui comptait dix-neuf maisons minuscules, mais pas les âmes qui les habitaient. Je pourrais les nommer une à une et leur rendre justice face au temps qui s'acharne à les effacer. Je pourrais mettre mes mains dans cette usine à oublis dans une tentative acharnée pour les sauver de la mort. Recréer leurs vies, revivre leurs amours... N'est-ce pas cela le rôle de la littérature?
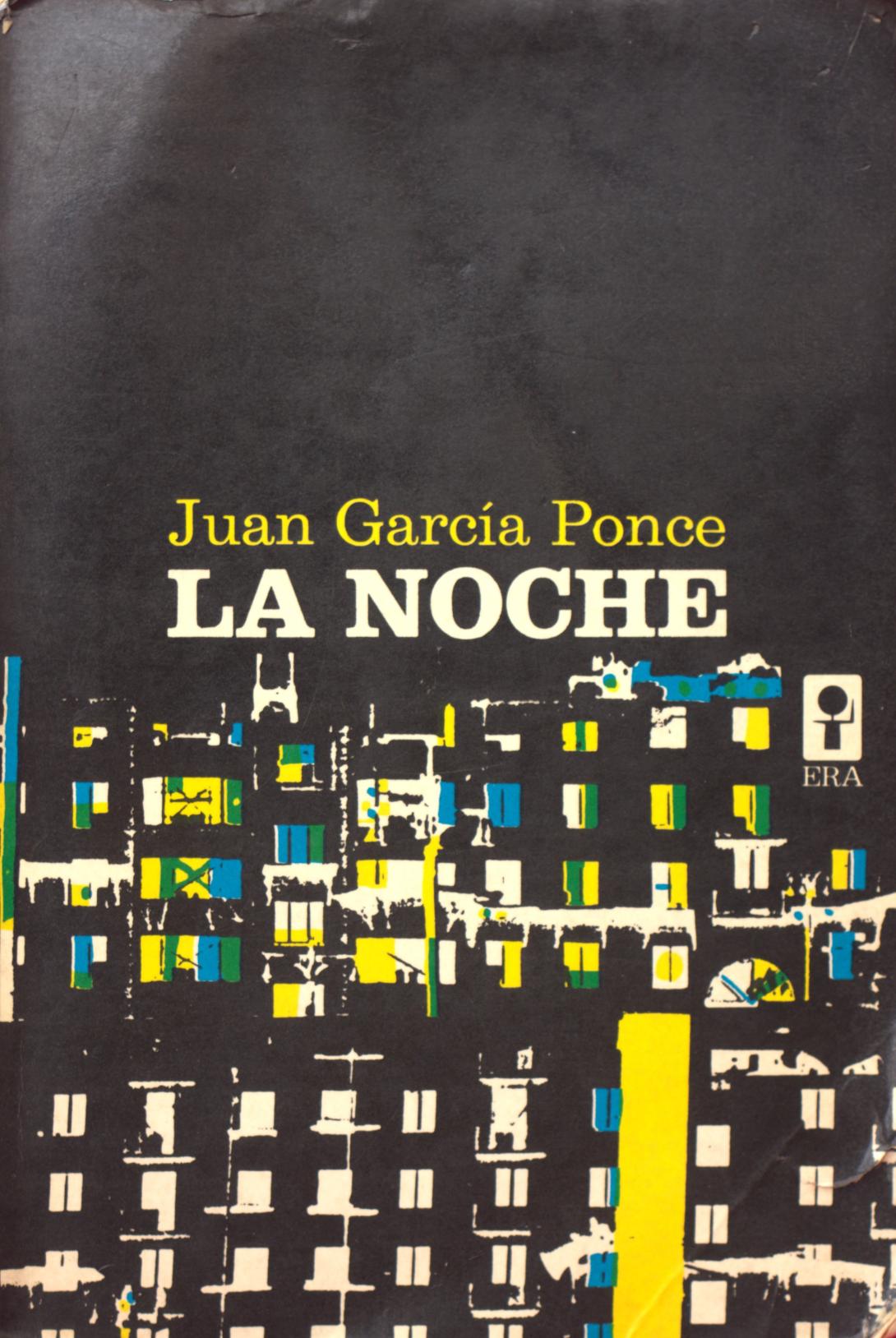 ERA
ERAJuan García Ponce | La Noche | ERA | 87 pages | 6,56 USD
Inclus dans un volume de nouvelles de 1963 intitulé La noche, "Tajimara" met en scène la relation amour-haine entre le narrateur et Cecilia, leurs rencontres et leurs désaccords, et " le jeu stupide et éternel " auquel il se livrait : " un égoïste masochiste qui avait trouvé la partenaire idéale". Ligne après ligne, le récit nous présente un inventaire des blessures. Par un après-midi pluvieux, alors que Cecilia l'emmène à une fête dans un village de la périphérie de Mexico appelé Tajimara, le narrateur se souvient des fois où il a fait le trajet avec elle jusqu'à l'atelier de Julia et Carlos, un couple de frère et sœur entre lesquels semble régner l'inceste. En écoutant le discours de Cecilia, le narrateur revient sur les années où il était éperdument amoureux d'elle, et les fois où il croyait l'avoir oubliée et où il la voyait réapparaître, après un certain temps, prête à raviver ses sentiments:
Auparavant, Cecilia et moi avions parcouru ces mêmes vingt kilomètres d'innombrables fois ; mais le paysage ne m'avait jamais semblé aussi mélancolique qu'aujourd'hui. Dans un sens, sa conduite a toujours été presque symbolique. Elle m'avait guidé vers ce qu'elle voulait, et quand, après six mois sans la voir, elle s'est soudain présentée pour m'inviter à nouveau à Tajimara, je n'ai même pas eu le temps de réfléchir à ce que je ressentais, j'ai simplement accepté, conscient que je ne saurais jamais si je l'aimais ou si je la détestais.
Quatre ans après la publication de "Tajimara", en 1967, García Ponce apprend qu'il est atteint de sclérose en plaques. Sa vie ne tient plus qu'à un fil. Peu à peu, il perdra ses capacités motrices. Sa voix, fluide jusqu'alors, va ralentir jusqu'à devenir sombre, maladroite, saccadée. Tout comme sa voix, c'est ce que j'écris ici : un récit qui veut avancer et qui s'inlisse dans les trous de ma mémoire.
Je ne sais pas si j'ai pris ce bus pendant mes six années de lycée, entre 1985 et 1990. J'aurais dû le prendre : il y avait une pénurie et le voisin ne m'a pas fait payer. Des choses terribles se sont produites dans mon pays au cours de ces années. L'éruption du volcan Nevado del Ruiz. La prise du palais de justice. L'assassinat du directeur du journal El Espectador : Guillermo Cano. La tragédie de Villatina. L'attentat à la voiture piégée contre le bâtiment du DAS. L'assassinat des candidats à la présidence Bernardo Jaramillo Ossa, Luis Carlos Galán et Carlos Pizarro Leongómez. Et entre ces événements, le retour de mon père.
La façon dont j'ai réagi à cet événement est terrible. Il avait quitté la ville après avoir rompu avec ma mère et, un jour, il est revenu nous rendre visite. Sachant cela, je me suis caché dans la cour. Je suis resté longtemps caché parmi mes poules. Il y avait quelque chose de García Ponce dans ce geste. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il portait toujours du noir, il répondait, en citant un personnage de Tchekhov : "Parce que je suis en deuil de ma vie". J'ai toujours porté des couleurs, et dans ma seule période monochrome, j'étais enclin à porter du blanc. Mais le deuil, comme la procession, va à l'intérieur. "Derrière chaque péché, il y a un pécheur qui se cache dans l'ombre et ne montre jamais son visage".
Quelque chose d'extrêmement fragile avait été brisé à ce moment-là : la confiance et l'amour que j'avais pour mon père. Je l'apprendrais plus tard, lorsque d'autres ont également perdu leur confiance et leur amour pour moi et que je me voyais, perdu sur le même chemin d'ivresse où il s'était perdu lui-même.
La première annonce du bus est venue à cinq heures : le voisin, après avoir mis de l'eau dans le radiateur, sonnait le capot dans le silence du petit matin. Cela se passait pendant que nous nous habillions. Ou encore dans nos rêves, nous obligeant à courir. Nous partions en bus plus tôt que les autres enfants. Dans les premiers mois de l'année, avec les rues encore sombres, et déjà vers le mois de mai avec le soleil qui tapait sur nos visages. J'utilise le pluriel parce que j'étais en compagnie d'autres enfants. Deux amis d'enfance. El Negro, qui allait à la même école que moi, et Puya, qui allait à une autre école. Nous passions devant notre école avant six heures, nous traversions la ville de bout en bout et seulement une heure plus tard, quand El Puya était parti et que nous étions sur le chemin du retour, El Negro et moi descendions, juste au moment où l'école ouvrait ses portes.
Un de ces matins, le voisin a pris ma mère à part. Il lui expliqua que l'une des passagères s'était plainte de l'utilisation du véhicule comme bus scolaire, et qu'elle avait donc dû me déposer en chemin, pour que la femme ne me voie pas. Mes amis n'étaient pas concernés : le Noir était le fils du voisin et la Puya était descendue un peu avant que la femme ne monte. Cela a dû me paraître une injustice. Que quelqu'un qui ne me connaissait pas me rabaisse... Il est arrivé quelque chose de semblable au personnage de "Tajimara". Sur un coup de tête, Cécilia le faisait monter et descendre du bus de ses sentiments :
Les après-midi interminables où j'essayais de la faire jouir, et l'odeur de nos corps après avoir parlé des heures durant dans le lit, les jambes entrelacées, tachant les draps de cendres. "Parfois, je ne ressens rien. Ça ne sert à rien. C'est toujours pareil. Je suis malade." Toujours avec qui ? Mais alors, en sueur, elle enroulait ses jambes autour de ma taille et je la cherchais à l'intérieur, et après s'être débattue et avoir gémi et soupiré, elle se détendait enfin et murmurait "merci, merci de m'avoir attendue" (...) Puis elle passait toute la journée avec moi. Je ne me lassais pas de la regarder. "Toi, toi." "Non, je ne suis plus celle-là. Ne rêve pas, n'invente pas. C'est fini."
Cécilia n'aimait qu'elle, mais il ne l'a pas remarqué. Ou peut-être l'a-t-il remarqué. L'amour et l'aveuglement voyagent dans le même bus, ils sont obligatoirement voisins de siège. Ce n'est pas pour rien que le narrateur dit : "Nous composons tout avec notre imagination et nous sommes incapables de vivre simplement la réalité".
Le voisin, je m'en souviens comme d'un honnête homme, aux principes moraux d'acier. Il était extrêmement rigoureux et réservé pour l'ambiance festive du quartier. Il aurait très bien pu décider de ne pas m'emmener, mais pour une raison ou une autre, il a choisi d'être permissif. Peut-être voyait-il en moi quelque chose de son fils, ou peut-être était-il hanté par un fantôme : celui d'avoir proposé, des années auparavant, de recueillir des signatures pour que nous quittions le quartier, après que ma mère se soit séparée de mon père et ait emménagé avec un autre homme.
Le fait est qu'à partir de ce jour-là, l'attente a commencé. Depuis cette heure, encore sombre, où le bus me déposait devant l'école. Depuis cette heure où je m'asseyais sur un rebord pour compter les minutes jusqu'à ce que le garde ouvre le portail. L'attente et la solitude dans cette rue où personne ne passait, ou les rares qui passaient baignaient encore dans l'eau du sommeil. Des gens qui se disaient à peine bonjour sans laisser de place à la moindre conversation. Alors j'aurais aimé lire "Tajimara".
Rencontrer Cecilia, la femme de l'histoire. Capricieuse comme personne, ridicule à l'excès, "fragile, absurde, timide et effrontée... si difficile à pénétrer et si déséquilibrée, et parfois aussi si stupide". Celle-là même qui m'a fait descendre du bus, je le sais maintenant, ramenée à ma réalité de ces années-là par une étrange boucle temporelle. Ce n'est qu'alors que je peux comprendre comment elle était, qui elle était, et ce qu'elle avait contre moi. Car je n'ai jamais su son nom et j'ai oublié son visage. Peut-être ne l'ai-je jamais vue, absorbé que j'étais par ce qui, en guise de découverte, s'offrait à moi à l'extérieur : le chaos matinal de ma première ville et, un peu plus tard, son cadeau de solitude : l'attente devant l'école encore fermée, et ce sentiment de déconsolation si semblable à celui de la perte d'un amour.



