Femmes riches, hommes stupides

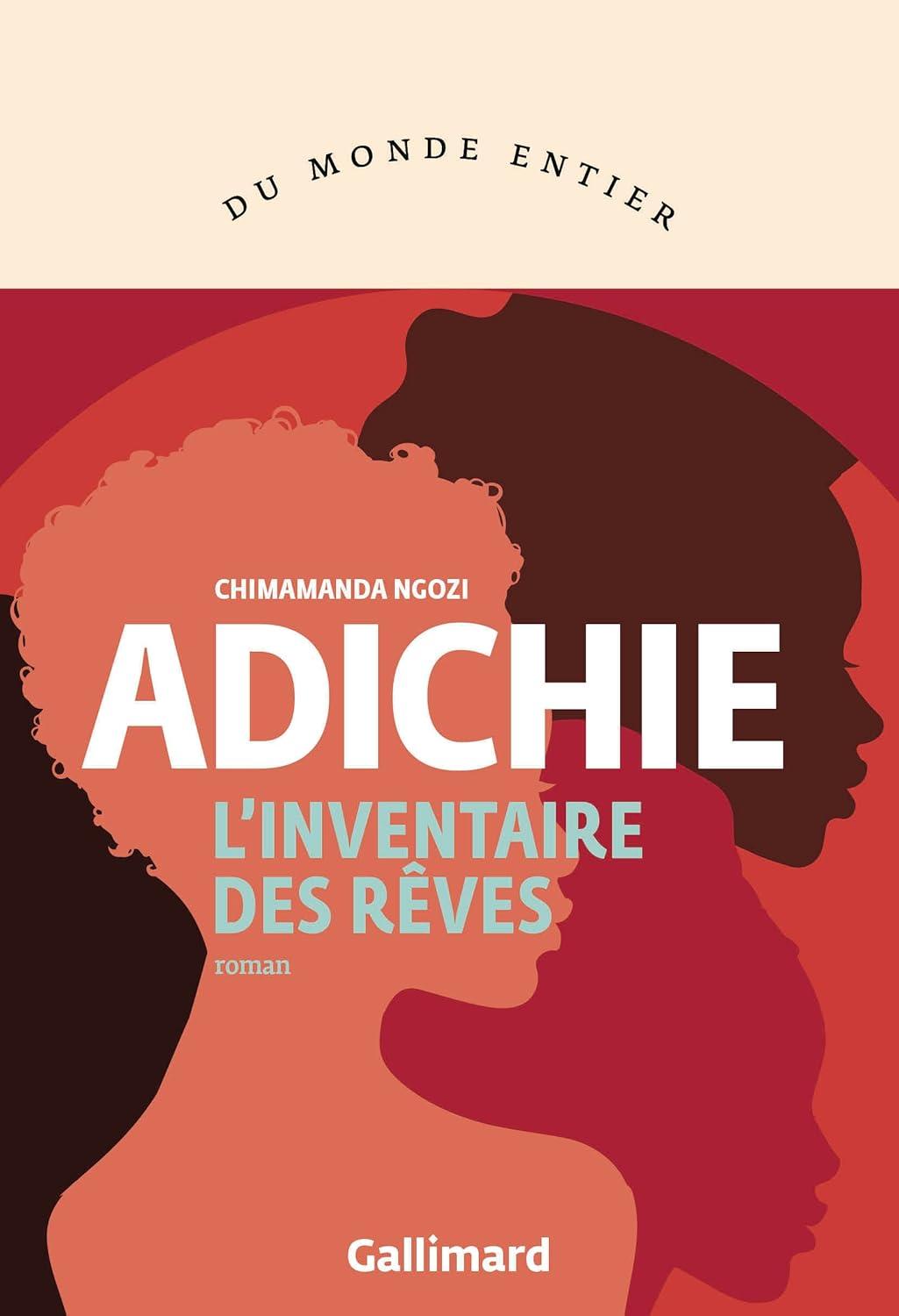 Gallimard
GallimardChimamanda Ngozi Adichie | L’inventaire des rêves | Gallimard | 656 pages | 26 EUR
The whole idea of a stereotype is to simplify. Instead of going through the problem of all this great diversity - that it’s this or maybe that - you have just one large statement; it is this. – Chinua Achebe
Moins par ses trois premiers romans que par ses légendaires TED-ups, Chimamanda Ngozi Adichie est une écrivaine qui a su s'imposer.Talks, l'auteure américano-nigériane Chimamanda Ngozi Adichie est devenue l'une des figures centrales de la littérature féministe postcoloniale. Ses romans denses et remarquablement composés Purple Hibisus (2001), Half of a Yellow Sun (2006) et Americanah (2013), les questions d'identité, de religion et de migration étaient encore traitées sous l'angle de la culture igbo occidentale et nigériane et les bouleversements historiques comme la guerre du Biafra ainsi que les discours sur le genre étaient intégrés dans des histoires denses et émotionnelles. Adichie a commencé à se réorienter après avoir reçu de nombreux prix et honneurs. Dans des TED Talks comme We Should All Be Feminists (2012), qui a non seulement été samplée par Beyoncé, mais aussi citée sur un T-shirt de Dior en 2016, Adichie s'est de plus en plus mise en scène comme une activiste consciente de la mode avec des qualités de pop star.
Le point culminant et peut-être l'aboutissement de cette évolution est son nouveau roman L’inventaire des rêves, qui a été publié simultanément en plusieurs langues début mars 2025 ; un honneur qui n'est accordé qu'à peu d'auteurs, comme ce fut le cas récemment pour une autre grande auteure de notre époque, Sally Rooney et son roman Intermezzo.
A la différence de Rooney, dont l'exploration de l'amour et de la vie se situe uniquement en Irlande, le roman d'Adichie est un livre international qui, comme Americanah d'Adichie, se situe aussi bien au Nigeria qu'aux Etats-Unis.
A l'époque, Adichie racontait encore l'histoire de jeunes en partance et d'expériences migratoires totalement différentes, et surtout d'une histoire d'amour finalement épanouie.
Douze ans plus tard, tout est différent. Adichie n'a pas seulement vieilli, son personnel a également vieilli et, avec eux, les conditions de vie ont gravement changé. Les conditions politiques et historiques, toujours importantes dans les romans précédents d'Adichie, ont presque disparu de son nouveau texte, si l'on excepte les implications politiques de la pandémie de Covid, qui constitue le cadre historique de L’inventaire des rêves, ou quelques cours de sexe sur la corruption.
Cependant, le passage du temps est plus évident dans les personnages d'Adichie - trois femmes riches dans la quarantaine qui peuvent peut-être être décrites comme des « Afropolitaines ». Un terme inventé par Taiye Selasi en 2005 dans son essai « Bye-Bye Babar » et 2013 avec son roman Ghana Must Go, qui fait référence aux Africains fortunés - ou aux personnes ayant des racines en Afrique - qui ont étudié en Amérique, en Angleterre ou à Paris et qui sont chez eux n'importe où dans le monde. Et une femme travaillant dans le secteur des services dont le pays d'origine est également le Nigeria, mais qui ne pourrait pas être plus différente.
Mais elles ont deux choses en commun : elles sont amies les unes avec les autres et elles ont toutes des problèmes avec les hommes.
Adichie n'entrelace toutefois pas ces histoires en un récit cohérent, mais raconte son histoire en alternant les points de vue.
Chacune des quatre femmes - Chia(maka), l'écrivaine voyageuse, ses anciennes amies Zikora et Omelogor et Kadiatou, employée comme femme de ménage chez Chia - reçoit "son" histoire en à peine cent pages. Dans le chapitre final, c'est encore une fois Chia qui est le point de vue de la fin de la pandémie et des grands drames de la vie des femmes.
Ces drames, chez Chia, Zikora et Omelogor, tournent essentiellement autour d'un amour non satisfait et d'hommes stupides, impitoyables ou simplement ignorants, qui ne correspondent ni aux exigences modernes et féministes des femmes, ni aux exigences que les femmes reçoivent de leurs parents encore attachés aux valeurs nigérianes. C'est surtout le désir d'enfant inassouvi ou tragiquement réalisé qui est traité de manière intensive par le biais de dyades parents-filles.
Parallèlement, Adichie tente de mettre l'accent sur l'histoire coloniale en faisant par exemple reprocher à l'un des partenaires de Chia, un scientifique afro-américain, que ses ancêtres igbo ont très probablement vendu ses ancêtres comme esclaves. Mais ces discours historiques légitimes sont peu denses et perdent rapidement leur impact à cause de connaissances stéréotypées et superficielles:
"Le problème, c'est que beaucoup de ces Blancs ne pensent pas que nous rêvons aussi", a-t-il dit.
Je suis resté bouche bée devant lui, étonné. "Yes," j'ai dit. "Yes, exactly."
Plus que l'histoire, Adichi s'intéresse dans son nouveau roman aux histoires d'amour tièdes qui, malgré leur surabondance, finissent toujours tragiquement pour toutes les femmes.
Cela rappelle les formats de séries télévisées comme Desperate Housewife's et Sex and the City, notamment par le caractère répétitif des histoires qui manquent d'ambivalence et qui finissent par ennuyer par leur univocité. Surtout parce que la morale de l'histoire est toujours la même, et qu'Adichie la récapitule sans cesse depuis son TED Talk We Should All Be Feminists et son adaptation en un essai du même nom en 2014 : Oser plus de féminisme pour que le monde change enfin.
Mais on ne croit que rarement à la souffrance de leurs héroïnes bien placées et à leur désir de changer le monde. Et le fait que l'argent ne fasse pas le bonheur est un proverbe tellement éculé qu'on n'a pas envie de le lire à chaque page d'un roman de plus de 600 pages.
Adichie tente toutefois, à travers le personnage de Kadiatou, d'élargir les itinéraires de vie redondants de son personnel de base aisé et crée un personnage de la classe inférieure qui doit non seulement subir de graves souffrances dans son pays natal, le Nigeria, mais aussi dans sa nouvelle patrie, les Etats-Unis.
Adichie entremêle ici très librement l'histoire de la femme de chambre Nafissatou Diallo, qui a été abusée sexuellement par l'homme politique français Dominique Gaston André Strauss-Kahn dans un hôtel de New York, avec la ligne de vie de son héroïne. Cela fait certes l'effet d'un corps étranger imposé dans le récit et n'atteint même pas l'intensité du roman de coming-of-age The Girl with the Louding Voice d'Abi Daré, mais offre enfin une petite étincelle de ce réalisme social qui fondait encore les premiers romans d'Adichie et qui est ici en grande partie sacrifié au profit d'une histoire de riches qui, dans le meilleur des cas, se disputent avec leur cuisinier privé sur l'importance de former une identité nationale par la cuisine indigène. Ou qui soutiennent leur femme de ménage dans sa lutte contre les avocats américains et les médias menteurs. Ou qui finissent par avoir un enfant, même si leur mari ne le veut pas.
Face aux trois grandes vagues du mouvement des femmes, cela semble bien poussiéreux, surtout lorsque des phrases d'une banalité à peine croyable apparaissent:
"There was no wavering will, no fear. Nous sommes en amour et puis nous ne sommes pas en amour. Où va l'amour quand on arrête d'aimer ?"
La réponse est celle qui rappelle Joseph Conrad et son Lord Jim : "Suivre le rêve, suivre le rêve encore et encore..." Mais chez Adichie, c'est d'une alternative d'une autre vie dont il faut rêver : "BUT SERIOUSLY, don't you ever dream of an entirely different life ?" Une phrase aussi importante que le titre de son roman, qui est bien sûr aussi une allusion subtile à la notion militaire de "body count" et qui doit peut-être aussi illustrer le fait que les sexes sont en guerre et que le rêve est donc d'autant plus important. Adichies ne dit toutefois rien sur la forme que pourraient prendre ces rêves. Car malgré tous les changements dans la vie de ses héroïnes, il n'y a pas que la vision de Kadiatou et de sa fille qui soit finalement une vision mièvre, lâche, presque kitsch, d'une nouvelle vie et d'une nouvelle époque.
Celui qui aspire à des idées plus satisfaisantes, plus excitantes et plus visionnaires devrait donc mettre de côté le roman d'Adichie et se tourner vers la dystopie afro-futuriste de Tlotlo Tsamaase Womb City, dans laquelle une héroïne véritablement post-féministe part à la découverte de nouveaux mondes et d'une nouvelle pensée rafraîchissante.



