A travers les paradigmes, avec éclat

Peter Baranowski est né à Francfort-sur-le-Main et a étudié la physique et l'arabe à Heidelberg, Berlin et Oxford avant de suivre le programme de réalisation de l'Université de la télévision et du cinéma de Munich.
Après avoir travaillé brièvement dans le secteur privé, il a réalisé des courts métrages primés tels que Rauschgift (lauréat à Locarno) et Bis ich es weiß (Toronto). Il a vécu en Asie centrale pour produire son long métrage Science et développe maintenant des projets dans sa société munichoise Rohstoff Film, en se concentrant sur l'intersection de la science et de l'art.
Si ChatGPT avait existé lorsque j'ai choisi une profession, je m'y serais probablement inscrit immédiatement. Trop de pistes me semblaient riches et prometteuses ; j'avais envie de déléguer la décision. Ma volonté de m'immerger dans un domaine était forte, mais mon incertitude quant au choix de ce domaine l'était tout autant. Le dilemme pouvait-il être résolu en choisissant quelque chose d'assez large pour habiter plusieurs mondes à la fois ? Mais qu'est-ce que cela pourrait être exactement ?
En y repensant, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai finalement choisi la physique. Je soupçonne qu'une version de l'affirmation de Stephen Hawking, selon laquelle la philosophie avait cédé la place à la physique, a joué un rôle. Aligné sur l'air du temps et nourri par la culture pop de la science-fiction, j'ai dû croire que les vaisseaux spatiaux et les télescopes nous rapprochaient des étoiles plus que ne pourrait le faire, par exemple, le récit de Dante sur le Paradis.
A l'université, cependant, j'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait pas avec la physique moderne. Ses approches de la réalité étaient riches, extravagantes, parfois subversives. Pourtant, rien de tout cela ne semblait se traduire dans l'expérience humaine. Aujourd'hui, je pourrais hausser les épaules, comme le font de nombreuses disciplines.
Une théorie respectée en physique prétend que lorsqu'un rayon laser passe à travers un trou minuscule, l'univers se divise en une infinité d'univers descendants. Vrai, profond, poétique ? Peut-être. Pourtant, même en principe, nous ne pourrons jamais accéder à aucun de ces univers, à l'exception de celui que nous habitons. De telles mises en garde assombrissent la plupart des comptes rendus des physiciens sur les côtés les plus sauvages de la réalité : toute la magie ne se produit "qu'au niveau quantique", "à une vitesse proche de celle de la lumière" ou même "avant l'espace et le temps". Ce qui m'a frustré, c'est que, de par leur conception, ces idées sont restées à l'écart de l'expérience vécue.
"Nous voyons maintenant à travers un verre, sombrement", peut-on lire dans une source de sagesse beaucoup plus ancienne, reconnaissant l'accès difficile de l'humanité à la vérité. Saint Paul a promis aux Corinthiens : "Mais alors nous verrons face à face", en référence à la vie après la mort. Le projet scientifique, en revanche, a longtemps cherché à placer ce "alors" fermement au sein de la vie. Pourtant, malgré ses succès - depuis l'émergence de la science aux XVIe et XVIIe siècles jusqu'à aujourd'hui - le problème de l'accès n'a jamais disparu. C'est peut-être là, dans l'interstice, que réside le véritable mystère.
La physique voit le monde à travers les mathématiques. Pour l'entrevoir clairement, les étudiants doivent étirer leurs ressources mentales jusqu'à la limite, et même au-delà. Personne que j'ai rencontré entre Heidelberg et Harvard n'a entrepris le recâblage nécessaire sans se poser de questions ; de nombreux survivants en sont sortis profondément marqués. Pourtant, si l'on ne maîtrise pas les mathématiques, on ne peut espérer rejoindre la tribu. Dans un tel contexte, se tourner vers l'histoire des sciences peut donner l'impression de fuir les équations différentielles les plus complexes pour s'installer confortablement parmi les erreurs du passé. Et pourtant, c'est précisément dans la zone grise entre l'histoire et la philosophie qu'en 1962, une véritable bombe a secoué la communauté scientifique - et m'a rapproché un peu plus des étoiles.
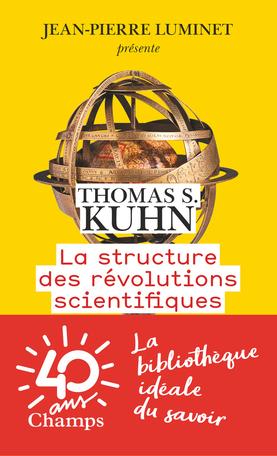 Flammarion
FlammarionThomas S. Kuhn | La structure des révolutions scientifiques | Edition Flammarion | 352 pages | 9 EURO
Thomas Kuhn, alors jeune physicien à Harvard, a publié La structure des révolutions scientifiques, remettant en question tout ce que l'on croyait sur le fonctionnement de la science. Alors que la plupart des gens imaginaient que le savoir progressait régulièrement, Kuhn a montré que le progrès se produisait par le biais de ruptures brutales et irréversibles.
Il a comparé ces ruptures à un interrupteur de Gestalt - la façon dont un dessin peut apparaître d'abord comme un canard, puis comme un lapin, sans que les lignes ne se déplacent. Une fois que le changement s'est produit, l'ancienne figure devient inaccessible. L'histoire des sciences offre de nombreux moments de ce type. Pendant des siècles, le cosmos de Ptolémée a placé la Terre au centre, le soleil et la lune étant considérés comme des planètes. Copernic n'a pas dessiné de nouvelles étoiles, mais la Terre est devenue une planète tournant autour du soleil. Le ciel n'a pas changé, mais le monde, lui, a changé. De même, le feu, autrefois considéré comme du phlogiston s'échappant de la matière, est devenu de l'oxygène se liant à elle sous la direction de Lavoisier. Les flammes semblaient identiques, mais brûlaient dans une nouvelle réalité.
Pour Kuhn, c'est là l'essence d'un changement de paradigme : non pas une lente accumulation de faits, mais une reconfiguration soudaine de la vision, lorsque la même preuve appartient à un autre monde. Tous les ponts sont alors brûlés : un changement de paradigme donne naissance à un nouveau mot, à une nouvelle langue, voire à un nouveau sens de la science. Les praticiens apprennent la nouvelle langue ou s'effacent en tant que professionnels. Kuhn a montré qu'il n'existe pas de langage neutre (peut-être même en principe) permettant aux paradigmes de dialoguer. Si les exemples étaient bien connus avant Kuhn, c'est l'ampleur de ses implications qui rend son travail révolutionnaire. Et son concept central de "changement de paradigme" est entré dans le langage courant.
En lisant, une question pressante s'est posée : pourquoi n'avais-je pas rencontré plus tôt ce que l'on appelle souvent l'une des contributions les plus importantes du 20e siècle à la compréhension de la science?
J'aime imaginer que la réponse est plus intrigante qu'un simple oubli. Et si la science elle-même conspirait contre moi, dissimulant la façon dont les changements de paradigme ébranlent ses fondements ? Comme le décrit Kuhn, les étudiants sont soigneusement initiés aux paradigmes en vigueur jusqu'à ce qu'ils les assimilent à la "façon normale" incontestée de faire de la science. Le travail quotidien ressemble alors moins à une grande découverte qu'à la résolution d'un puzzle, c'est-à-dire à l'assemblage des pièces selon les règles du paradigme. Des générations entières peuvent passer leur carrière dans ce que Kuhn appelle sans ambages la "science normale".
Pourtant, alors que beaucoup pensent que cette image représente la nature elle-même, Kuhn insiste sur le fait qu'elle ne le fait que dans les limites du paradigme. Au fil du temps, des fissures apparaissent : des phénomènes s'accumulent qui résistent à l'explication avec les outils disponibles. Le paradigme entre en crise jusqu'à ce qu'un nouveau cadre soit forgé. De telles révolutions sont rarement le fait de maîtres établis ; elles sont plus souvent le fait de nouveaux venus, qui n'ont pas encore investi dans "la manière de faire les choses". La conversion est inégale : la vieille garde résiste, et un nouveau paradigme ne s'impose souvent que lorsque ses prédécesseurs ont disparu. A la génération suivante, le nouvel ordre est tellement assimilé que son caractère provisoire disparaît.
Pour la plupart des scientifiques, ces moments n'arrivent jamais ; les carrières se déroulent dans le cadre d'une "science normale" stable. Mais c'est à la marge, lors des crises, que les limites de la science sont exposées. C'est là que ma fascination est ravivée. Les limites sont une invitation à rêver différemment, à saisir la réalité à la racine. La physique semblait autrefois promettre un tel privilège, mais dans la pratique, cette promesse est consumée par le culte de la "voie normale".
Pour nous, contemporains, un point aveugle dans les écrits de Kuhn confirme presque parfaitement sa thèse : il parle du "scientifique" comme si les femmes - ou toute autre personne en dehors de ce pronom - n'existaient pas. A l'époque, cet usage passait inaperçu ; aujourd'hui, il saute aux yeux comme un anachronisme révélateur. Même la prose de Kuhn a subi son propre changement de paradigme : autrefois transparente, elle est aujourd'hui problématique, rappelant que la "normalité" est toujours sujette aux révolutions silencieuses de l'histoire.
Aujourd'hui, on a presque l'impression que Kuhn s'est protégé lui-même de cette critique en confinant les paradigmes aux sciences naturelles, où le terme a un sens plus précis. Il en a reconnu le potentiel ailleurs, mais il s'en est tenu à un champ d'action restreint. Pourtant, en lisant Structure, j'ai instinctivement testé ses idées dans d'autres domaines. Et vers quoi d'autre pouvais-je me tourner sinon vers le domaine où, après avoir mis la physique de côté, j'ai trouvé un refuge intellectuel et spirituel : le cinéma.
Le cinéma n'a-t-il pas, lui aussi, des paradigmes - ces cadres tacites à travers lesquels nous sommes formés à voir, interpréter et déclarer des œuvres "art" ou "divertissement" ? Dans quelle mesure est-ce un accident - ou une nécessité - que l'esthétique soit si étroitement liée à l'idéologie et au discours politique ? Et n'y aurait-il pas une autre façon de voir, moins liée à la "normalité", qui redonnerait à l'art le pouvoir de troubler, d'éclairer, voire de transfigurer ?
Toute personne ayant vécu une expérience esthétique profonde sait à quel point le monde peut sembler étrange par la suite. Voir la réalité à travers les vrais maîtres du cinéma, c'est non seulement pénétrer dans de nouveaux mondes, mais aussi transformer le quotidien. Après Yasujiro Ozu, les discussions banales sur la vie de famille semblent hantées par la tendresse tranquille et mélancolique du réalisateur japonais. La lumière du soleil qui scintille à travers des ombres feuillues sur un ruisseau verdâtre me transporte dans les pastorales humides et oniriques d'Apichatpong Weerasethakul. Et apercevoir la vie à travers l'objectif de Terrence Malick, qui ressemble à une prière, c'est sentir la sainteté scintiller juste sous la surface des choses.
Même les non-cinéphiles perçoivent la réalité à travers un objectif cinématographique, teinté de mémoire et d'imagination. Un voyage au Grand Canyon peut faire apparaître des cow-boys fantômes ; la manœuvre d'un politicien peut être considérée comme une capitulation devant "le côté obscur de la Force". Au-delà de ces échos, des fragments cinématographiques habitent nos rêves éveillés - les gestes, les humeurs et les images fugaces qui façonnent notre vision du monde.
Bien que le progrès artistique diffère de la science, les découvertes esthétiques ouvrent de nouveaux mondes, comme les paradigmes de Kuhn. Nous ne pouvons pas revenir à un cosmos géocentrique, ni ignorer la façon dont Vinci a rendu la forme humaine. Certaines façons de voir sont en sommeil jusqu'à ce qu'une voix authentique les réveille. Malgré les lamentations sur la vie contemporaine, l'une des raisons pour lesquelles je ne souhaiterais jamais vivre dans le passé est la simple indisponibilité de certaines de ces perspectives. Visiter l'Eden sans Weerasethakul, c'est comme posséder l'accélérateur de particules le plus avancé mais ne pas pouvoir accéder au modèle standard.
Aujourd'hui, même les enfants jouent avec des maquettes du système solaire, considérant comme acquis que nous tournons autour d'une étoile ardente. Mais quel voyage ce fut - et combien il reste étrangement difficile d'imaginer le monde autrement. Au-delà des exemples astronomiques évidents, l'exposé de Kuhn sur le tableau périodique m'a semblé particulièrement captivant. Considérez l'immense variété de choses - vivantes et mortes, chaudes et froides, fluides et gazeuses, brûlantes ou gelées, des millions de textures - perçues comme des blocs de construction élémentaires, chacun numéroté de 1 à 118.
C'est dans ces envolées de l'imagination que les plaisirs de la lecture de Structure deviennent vifs. Dès la première page, il est clair qu'il s'agit d'un ouvrage de passion, né d'un désir profond de plonger dans les rouages de la science - pas seulement dans un coin, mais dans l'ensemble. Cette portée élève le livre, donnant aux lecteurs un rare sentiment d'autonomisation intellectuelle, comme si une sagesse cachée était transmise, rendant le monde plus riche et la compréhension plus profonde. Ce livre n'est pas facile à lire, mais il n'est pas non plus impénétrable. Et surtout, il est authentique : il ne s'agit pas d'une version "grand public" diluée, mais d'un penseur qui vous invite à pénétrer au cœur de sa vision.
Aujourd'hui, la physique a perdu une partie de l'éclat dont elle jouissait auprès du public lorsque Kuhn a commencé. Les percées se poursuivent dans toutes les sciences, mais peu d'entre elles pénètrent dans la conscience collective pour nous obliger à voir le monde différemment. Avec le recul, on a presque l'impression que Kuhn a écrit à un moment où la visibilité de la science était à son maximum.
Même s'il a été libéré de son ancrage strict dans les sciences naturelles, le récit de Kuhn sur les changements sismiques semble plus pertinent que jamais. Le monde est-il vraiment le même après l'internet, les smartphones ou les grands modèles de langage ? Pas seulement d'un point de vue métaphorique, mais à tous égards significatifs ? Le "savoir" a-t-il un poids différent après le TPG ? La "compréhension" change-t-elle lorsque les machines partagent un mode de raisonnement autrefois exclusivement humain ? Comme les révolutions scientifiques, ces transformations technologiques ne s'accumulent pas étape par étape ; elles rompent le monde soudainement. Et tout comme Kuhn a observé que les praticiens qui refusaient le paradigme en vigueur cessaient d'être reconnus comme des scientifiques, de même ceux qui se détournent de ces technologies risquent de perdre leur participation à la vie contemporaine.
Et pourtant, détester l'IA, c'est comme détester la roue. Bien que je n'aie jamais eu une très haute opinion des ordinateurs auparavant, je ne peux m'empêcher de penser que cette révolution pourrait rivaliser avec l'impact de Galilée, voire le dépasser. Dans son sillage, beaucoup pourraient se sentir tragiquement comme des machines lentes, sujettes aux erreurs et dotées d'une mémoire limitée - une humiliation silencieuse intégrée à la vie quotidienne. Dans une telle phase, l'activité intellectuelle peut sembler réduite au remixage sans fin de nos archives de connaissances et d'art.
Je ne suis pas un historien des sciences, et retracer Kuhn pour évaluer la technologie moderne dépasse mes compétences. Ma fascination réside ailleurs : dans la sympathie pour une passion rayonnante de comprendre à grande échelle, de résister aux "méthodes normales" modernes de fragmentation du savoir. Cette ambition de penser à grande échelle, de créer des systèmes cohérents, est ce que j'associe à la culture intellectuelle américaine de la fin du XXe siècle - à côté de Kuhn, pensons à Jared Diamond, Douglas Hofstadter, Marshall McLuhan, Susan Sontag, Noam Chomsky et d'autres. Chaque ouvrage porte la marque d'un pouvoir intellectuel extatique, d'un aperçu derrière le voile de la complexité, dévoilant des idées profondes alors même qu'elles se heurtent aux limites de notre compréhension.
Oui, nos paradigmes peuvent façonner et restreindre à jamais ce que nous pouvons voir, nous empêchant d'accéder à l'absolu. Pourtant, en sondant le vaste territoire de nos limites, Kuhn a ouvert de nouveaux mondes. Il nous rappelle qu'aucun paradigme ne peut être le dernier mot de notre voyage de découverte, et il le fait avec beaucoup de passion, de curiosité et d'intégrité. C'est peut-être précisément cette possibilité d'auto-réflexion radicale qui me fait croire que nous sortirons également de l'actuel éloignement de l'IA avec une compréhension plus profonde - et un amour - de ce que nous sommes vraiment.
Lorsque j'ai choisi une profession, j'ai craint les contraintes d'un seul domaine. Pourtant, c'est peut-être précisément dans nos limites que les choses les plus importantes deviennent visibles et que la possibilité de transcendance apparaît. Et ce n'est pas quelque chose que nous pouvons déléguer.
Oui, nous ne voyons jamais qu'à travers des paradigmes. Brillamment.
Ce texte vous a plu ? Alors soutenez notre travail de manière ponctuelle, mensuelle ou annuelle via l’un de nos abonnements !
Vous ne voulez plus manquer aucun texte sur Literatur.Review ? Alors inscrivez-vous ici !



