Lorsque l'Amérique a été divisée

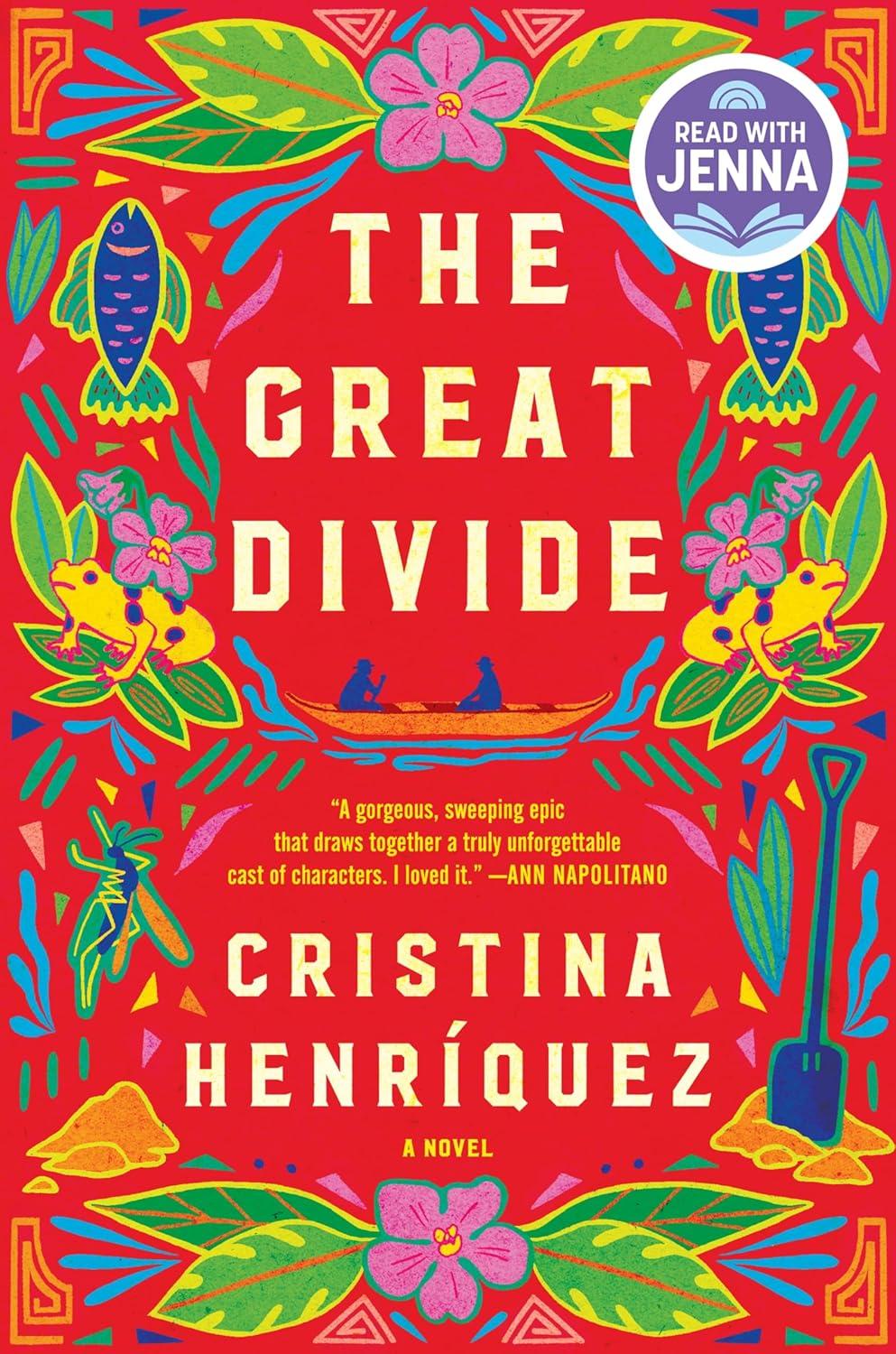 Ecco
EccoCristina Henríquez | The Great Divide | Ecco | 336 pages | 24 USD
Pendant près de quarante ans, j’ai dit sans gêne « Amérique » quand je parlais des États-Unis. Ce n’est qu’un stagiaire, dont les parents étaient venus en Allemagne depuis l’un des pays d’Amérique centrale, qui m’a fait prendre conscience de l’ignorance coloniale qui fait partie intégrante du répertoire standard de l’autoperception américaine : Nous sommes l’Amérique ! Je ne me souviens plus — étais-je culturellement ignorant ou simplement vieux et oublieux ? — ni du pays d’origine de ses parents, ni du nom du stagiaire. Cette rencontre a tout de même laissé des traces. Aujourd’hui, si quelqu’un dit « Amérique » autour de moi en voulant parler des États-Unis, je le corrige.
C’est probablement tout à fait dans l’esprit de l’autrice américaine Cristina Henríquez, qui a situé son roman La Grande Déchirure (The Great Divide en version originale) à l’un des points de jonction les plus symboliques du double continent américain : le canal de Panama.
Comme tant d’autres gigantesques projets d’ingénierie de l’époque moderne, la construction du canal a été menée avec une implacable rigueur technocratique au cours des deux premières décennies du XXe siècle. Henríquez oppose aux récits géopolitiques et stratégiques habituels sur l’importance du canal un tissu riche d’histoires individuelles, multiples et entremêlées.
Il y a Ada, 16 ans, venue de la Barbade pour gagner de l’argent dans l’ombre du mégaprojet, afin de pouvoir faire opérer sa sœur atteinte d’une maladie pulmonaire. Francisco, un pêcheur mélancolique, qui a failli perdre son fils Omar à cause de la construction du canal.
John, un scientifique américain qui tente d’éradiquer la malaria et perd, ce faisant, sa femme Marian. Et Valentina, arrachée à la monotonie de son quotidien lorsqu’elle organise la résistance contre le projet de déplacement forcé de son village natal.
Henríquez, fille d’un père panaméen et d’une mère américaine, oppose un changement de perspective au regard colonial que portent les États-Unis sur le canal, un regard redevenu particulièrement populaire à Washington ces derniers temps. Car vu depuis le sud ou le centre du double continent, le canal apparaît davantage comme une ligne de séparation (divide) que comme un lien, alors que c’est justement cette fonction de liaison qui devrait être l’essence même d’un canal. Petit retour en arrière : ce n’est qu’à la faveur d’une intervention militaire des États-Unis qu’a pu avoir lieu, en 1903, la sécession de l’ancienne province du Panama vis-à-vis de la Colombie. La même année, le gouvernement américain conclut avec les nouvelles autorités le traité dit Hay-Bunau-Varilla, qui instaure une zone de souveraineté américaine autour du futur chantier du canal. En 1904, les travaux débutent sous la direction d’ingénieurs de l’armée américaine. Dès 1914, le premier navire emprunte cette voie navigable longue de 82 kilomètres. C’est quelque part dans ces dix années, entre le début des travaux et leur achèvement, que se déroulent les histoires racontées dans le roman.
Ce qui, d’un point de vue colonial, apparaît comme une incroyable success story est, dans le texte de Henríquez, ramené à son noyau socio-économique : la construction du canal n’est rien d’autre qu’un acte de plus dans la représentation sans fin du grand théâtre du monde.
Au cœur de l’Amérique, on travaille, on aime, on trahit, on meurt, on espère et — avec un peu de chance — on survit. Le racisme, profondément enraciné dans le quotidien, est partout, les femmes n’ont au mieux que des rôles secondaires symboliques, et les droits de participation démocratique, s’ils existent, ne s’appliquent qu’aux maîtres d’ouvrage.
Cristina Henríquez a mené des recherches minutieuses pour son roman. Elle tente de maîtriser cette profusion de matériaux par un réalisme littéraire qui rappelle les romans de critique sociale du XIXᵉ siècle. Ses incursions dans le réalisme magique d’Amérique centrale et du Sud s’estompent généralement après quelques pages, se fondant dans le flux narratif général. Mais le grand mérite du roman réside dans sa capacité à entrelacer une multitude de petites histoires pour composer un tableau d’ensemble de ce projet du siècle, qui continue de diviser le double continent à ce jour.



